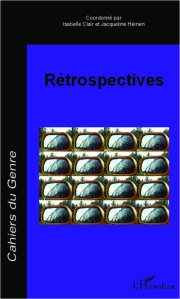 « Revenir à l’histoire des définitions et aux débats qu’elles ont engendrés s’avère indispensable pour saisir la «polysémie du mot « genre », ainsi que les éventuels malentendus et désaccords que suscite son usage ».
« Revenir à l’histoire des définitions et aux débats qu’elles ont engendrés s’avère indispensable pour saisir la «polysémie du mot « genre », ainsi que les éventuels malentendus et désaccords que suscite son usage ».
En introduction, Isabelle Clair et Jacqueline Heinen soulignent la nécessité de « restituer l’histoire des concepts et des usages, pour s’efforcer d’en cerner certaines particularités contemporaines ».
En complément d’autres dossiers publiés antérieurement, « L’accent portera cette fois sur la production des concepts au sein d’institutions académiques et éditoriales : bien que ces dernières soient plus ou moins liées aux mouvements féministes, elles suivent aussi des dynamiques qui leur sont propres. On s’intéressera donc ici à des textes académiques et à leurs auteur.e.s, aux maisons d’éditions et aux revues scientifiques qui les ont publiés ».
Je choisis de ne mettre l’accent que sur certains articles et certaines analyses, comme invitation à lire ce riche numéro en « rétrospectives ».
Les entretiens croisés entre Oristelle Bonis, Cynthia Kraus et Gail Pheterson soulignent, me semble-t-il, à la fois les problèmes de traduction/translation de notions, entre langues et contextes, et à la fois une certaine contingence dans les choix. Ces éléments devraient permettre de relativiser certains débats, de réfléchir aux sens plutôt qu’aux termes.
Oristelle Bonis indique, par exemple : « Ainsi, j’avais traduit situated knowledges par « connaissances situées », mais l’expression « savoirs situés » était déjà couramment employée, sémantiquement inscrite, et je l’ai donc adoptée – un peu à contrecœur parce que « savoir » est un mot plus globalisant, plus élitiste que « connaissances ». »
Les remarques sur les vocables « gender relations », « système de genre », « gendered », « genré », « marché aux femmes », « sexe social » ou « rapports sociaux de sexe », etc. sont aussi très éclairantes
Devant cette difficulté à rendre tous les sens, j’adopte personnellement le plus souvent « rapports sociaux de sexe » en ajoutant entre parenthèses (système de genre) et quelque fois (patriarcat). La difficulté est de même ordre pour les « recouvrements », les entrecroisements. Je trouve sur ce sujet que les formules de Danielle Kergoat « rapports sociaux consubstantiels et coextensifs » plus ouvertes à la complexité que la notion d’ « intersection ».
Oristelle Bonis souligne aussi que « on traduit littéralement, et ce faisant on attribue au mot une signification supplémentaire, on l’affecte à un autre usage », et donne l’exemple de « Genre » comme catégorie d’analyse utile, « même s’il est parfois effectivement utilisé à contre sens, pour dire « sexe » en ne le disant pas ».
Gail Pheterson, indique, entre autres : « Quand j’ai trouvé l’expression « rapports sociaux de sexe », en France, tout de suite ça a eu une résonance pour moi, et j’ai ressenti une sorte de soulagement d’avoir trouvé une issue aux cadres identitaires (par définition, figés) et psychologisants (individualisants même quand les causes sont attribuées au social) ; le concept de « rapports sociaux de sexe » permettant de saisir la dynamique, le sens et l’usage politique de la catégorisation par sexe ». Elle souligne aussi la combinaison des « mythes au niveau biologique » et « des réalités fortes aux niveaux politique et social » ; la nécessité de « ne pas faire disparaître les femmes de la formule des rapports de pouvoir ». Je reste en opposition à ses formules sur le « travail du sexe ».
J’ai apprécié les remarques de l’auteure sur l’humour yiddish et sa phrase conclusive : « Faire justice à un humour tourné contre les conventions hypocrites ou bien contre soi-même n’est pas évident en traduction ».
J’indique pour en terminer avec ces entretiens, mon accord avec Oristelle Bonis sur le langage, « Mais choisir d’utiliser des termes techniques, c’est aussi cibler son lectorat d’une façon très particulière, le rétrécir ou le fermer » ou « Moi qui suis une féministe généraliste, je trouve dommage pour le débat, pour la diffusion d’idées, que la recherche féministe soit à ce point tributaire d’un vocabulaire spécialisé. » Sur ce point, les explications de Cynthia Kraus ne me semblent pas convaincantes « dans la difficulté même de lire, se répercute un travail sur la langue qui vise à agir sur le sujet qui lit, une réflexion sur l’activité de lecture ».
Je rappelle qu’Oristelle Bonis anime une maison d’éditions iXe http://www.editions-ixe.fr/ aux publications passionnantes et qui applique la règle de proximité (« les hommes et les femmes sont belles »).
« Le féminisme du positionnement » de Sarah Bracke et María Puig de la Bellacasa est inscrit « dans les débats féministes sur les liens intimes et inextricables entre lutte politique et production du savoir ». Les auteures prennent l’héroïne grecque Antigone comme accompagnatrice.
« La théorie féministe du « positionnement » (standpoint), considère l’expérience des femmes comme une source de savoir susceptible d’être déployée pour transformer la sphère publique dont elles sont exclues ».
La vie des femmes constitue une « position privilégiée, d’un point de vue épistémologique ». J’aurai écrit donne un avantage (et non un privilège comme certaines le disent) épistémologique.
Les féministes ont mis en avant « la cécité résultant de l’ignorance dans laquelle sont tenus les activités et les savoirs les plus élémentaires qui assurent la bonne marche de notre monde ». Cécité volontaire. Les apports du « Black femininism » sont importants sur le sujet. (Voir, entre autres, Black femininism : Anthologie du féminisme africain-américain, 1975-2000, textes choisis et présentés par Elsa Dorlin, Editions L’Harmattan 2008, Sujet politique du féminisme – qui est ce NOUS de » Nous les femmes » ?). Certes, « l’expérience et le savoir ne sont pas des choses équivalentes ». Mais il convient, comme l’indiquent les auteures de rester attentifs/attentives aux expériences pouvant être source de nouveaux savoirs. Sarah Bracke et María Puig de la Bellacasa soulignent aussi le risque de masquer des rapports de pouvoirs en créant une unité artificielle des femmes et de leurs activités, unité qui reste à construire. Hill Collins, citée par les auteures, parle d’une « multiplication des positions inscrites dans les structures sociales elles-mêmes ». D’où la nécessité de développer des analyses « intersectionnelles » et de construire des solidarités, qui impliquent « un effort politique ».
Je reste plus dubitatif sur la notion d’agentivité (agency), car dans aucun rapport social, les êtres humains ne sont réduite-s à des objets, elles et ils sont tout à la fois dominé-e-s et « autonomes », actrices/acteurs dans les contradictions toujours présentes dédits rapports.
Les auteures terminent ainsi : « En refusant de retrancher certaines expériences du domaine politique pour les confiner dans l’individuel ou le privé ; en constituant des alliances permettant la réflexion, l’organisation et le partage collectifs d’expériences exclues et atomisées ; et en reconnaissant que de telles expériences ne vont pas de soi, elles peuvent précisément devenir des ressources disponibles pour une action et un savoir générateurs de changement ». J’ajoute que c’est aussi probablement une des conditions pour que l’horizon d’un changement radical puisse se ré-ouvrir.
Sans revenir sur les apports, et en particulier, de la notion de citoyen-ne-s, et les droits reproductifs comme dimension de la citoyenneté, dans l’analyse du Groupe « État et rapports sociaux de sexe », je suis étonné d’un oubli. Les auteures indiquent : « Si le processus d’émancipation amorcé voici près d’un demi-siècle a contribué à libérer les unes d’une partie des tâches qui leur étaient traditionnellement assignées, il s’est souvent opéré aux dépens des autres – au premier chef des immigrées issues de cultures et de pays divers ». Si des femmes sont en effet libérées de certaines tâches, elles ne le sont pas du souci de ces tâches. Par ailleurs, les bénéficiaires en sont toujours les hommes qui se dispensent et de s’en soucier et de les réaliser à « égalité » avec les femmes…
Le dernier article que je voudrais aborder est celui d’Isabelle Clair. Le titre de ma note en est tiré. L’auteure interroge : « Pourquoi penser la sexualité pour penser le genre en sociologie ? Retour sur quarante ans de réticences » et présente les « réticences raisonnées et historiquement situées » à cette inclusion. Parmi celles-ci, j’en souligne deux : la crainte de la relativisation du travail, la possible mise en sourdine de l’intérêt des hommes à maintenir leur domination.
L’auteure écrit « penser l’ensemble des exclusions sociales et des hiérarchies organisées par les normes de genre, c’est faire la place à l’hétéronormativité ainsi qu’à l’ensemble des sexualités, et aux deux groupes de sexes ». Si dans le système de genre, les deux « classes de sexe » sont déjà présentes dans leur asymétrie de pouvoir et de domination, il ne me semble pas possible de penser les dominations sans prendre en compte l’hétéronormativité. Et la proposition de penser ensemble le genre et la sexualité est donc un enrichissement. Reste ce qui peut-être entendu par « ensemble ».
Pour l’auteure la pensée de l’intersection du genre et de la sexualité est une pensée fructueuse « Non seulement parce qu’elle éclaire les sexualités diverses que (même) l’analyse féministe a eu tendance à laisser dans l’ombre du privé, mais surtout parce qu’elle éclaire le concept de genre, révélant des enjeux de définition et d’usage que ses versions françaises tendent à laisser en suspens ».
Si les sexualités relèvent de rapports sociaux et non d’une nature préexistante, comme je le pense, l’éclairage se précise. L’auteure indique, en évoquant la division sexuée du travail, que « tant que la sexualité était hors sujet, la polysémie était invisible ». Cela permet de mieux déconstruire le bloc, que certain-e-s persistent à présenter, dans lequel « genre, sexe et désir coïncident ».
Parmi les arguments développés, je souligne ceux sur la fausse opposition (opposition construite idéologiquement) entre nature et culture (et donc l’invention d’une nature naturelle préexistante aux rapports sociaux), l’empilement des rapports de pouvoirs (et non leur coextensivité).
Isabelle Clair ajoute : « Si la réalité sociale du genre ne peut toute entière être saisie par le prisme de la sexualité, ni la réalité sociale de la sexualité par celui du genre, il est néanmoins important de souligner que les normes de féminité et de masculinité, les déviances sexuelles, les rapports de pouvoir entre sexualités façonnent de nombreuses manifestations du genre – au-delà des seules pratiques sexuelles ».
Cela ne signifie pas que « la sexualité précède le genre » comme le dit Elsa Dorlin, citée par l’auteure. Il me semble plus judicieux de « privilégier l’intersection sans nécessaire hiérarchie ou antériorité entre genre et sexualité » comme le propose Isabelle Clair. Celle-ci ajoute : « J’envisage plutôt la sexualité comme un foyer possible de la fabrique du genre : non seulement un de ses « sites privilégiés » (key site) de manifestation (Jackson 2005 p15) mais une source d’organisation de la complémentarité (et donc d’asymétrie) entre les groupe de sexes ».
Je partage enfin la remarque « il est également important de souligner l’heureuse difficulté à faire rentrer les pratiques sociales dans des décisions théoriques abstraites »…
Un texte à mettre en regard de son ouvrage de synthèse : Sociologie du genre, Armand Colin 2012, Regarder le monde avec les lunettes du genre sur le nez, c’est la promesse de le voir plus nettement
La limitation de cette note à ces quelques articles ne saurait dispenser de lire les autres contributions très riches elles aussi. J’indique juste que celui de Jasbir K. Puar me semble difficile à lire. Peut-être à cause de mon éloignement de ce vocabulaire et de notions peu explicitées, comme d’ailleurs dans son livre paru aux Editions Amsterdam. J’avais donc renoncé à le chroniquer malgré l’intérêt de certaines analyses que j’avais réussi à saisir. Quoiqu’il en soit, ce numéro montre la puissance d’analyse des concepts élaborés par les féministes et leur caractère indispensable pour aborder les rapports sociaux, les dominations et donc l’émancipation.
Sommaire
Jules Falquet et Helena Hirata : À la mémoire de Bruno Lautier (1948-2013)
Dossier
Isabelle Clair et Jacqueline Heinen : Le genre et les études féministes françaises : une histoire ancienne (Introduction)
Oristelle Bonis, Cynthia Kraus et Gail Pheterson : Translations du genre. Entretiens croisés (propos recueillis par Isabelle Clair et Jacqueline Heinen)
Sarah Bracke et María Puig de la Bellacasa : Le féminisme du positionnement. Héritages et perspectives contemporaines
Groupe « État et rapports sociaux de sexe » : Quelle citoyenneté pour les femmes ? État des lieux et perspectives (1987-2012
Isabelle Clair : Pourquoi penser la sexualité pour penser le genre en sociologie ? Retour sur quarante ans de réticences
Nicky Le Feuvre, Pierre Bataille et Laura Morend : La visibilité du genre dans des revues de sociologie du travail. Comparaisons France et Grande-Bretagne (1987-2012)
Jasbir K. Puar : Homonationalisme et biopolitique
Hors-champ
Virginie Vinel : Biographies individuelles et actions collectives : le militantisme féminin dans une vallée sidérurgique lorraine
Manuela Lavinas Picq : Porter le genre dans la culture : femmes et interlégalité en Équateur
Notes de lecture
Cahiers du genre : Rétrospectives
Coordonné par Isabelle Clair et Jacqueline Heinen
Editions L’Harmattan, Paris 2013, 270 pages, 24,50 euros
Didier Epsztajn
