 « Au cœur même de cette longue crise du capitalisme, une volonté de « prendre ses affaires en mains » se manifeste face aux licenciements, aux fermetures d’entreprises et aux destructions multiples. Ici et là, un peu partout dans le monde, des travailleuses et des travailleuses occupent leurs entreprises, se saisissent de l’outil de travail et remettent en marche la production. Vieux de quarante ans, le slogan de Lips, « On fabrique, on vend, on se paie », semble donner le la d’une réponse offensive des citoyen.nes et des salarié.es à la situation qui leur est faite », des réalités, sous-estimées, mais soulignées par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka dans leur introduction : « Marx et Engels et la coopération ».
« Au cœur même de cette longue crise du capitalisme, une volonté de « prendre ses affaires en mains » se manifeste face aux licenciements, aux fermetures d’entreprises et aux destructions multiples. Ici et là, un peu partout dans le monde, des travailleuses et des travailleuses occupent leurs entreprises, se saisissent de l’outil de travail et remettent en marche la production. Vieux de quarante ans, le slogan de Lips, « On fabrique, on vend, on se paie », semble donner le la d’une réponse offensive des citoyen.nes et des salarié.es à la situation qui leur est faite », des réalités, sous-estimées, mais soulignées par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka dans leur introduction : « Marx et Engels et la coopération ».
« … création de coopératives, réquisitions des biens vacants, expropriations, récupérations d’entreprises, grèves actives avec reprise de la production, contre-plans « ouvriers », contrôle ouvrier et populaire, autogestion, etc. Les « expériences de mise en commun pour développer des activités socialement utiles ponctuent la lutte des classes et sont l’embryon, le banc d’essai de la réponse de la société des citoyen.nes associé.es pour faire face à la guerre capitaliste »
Je choisis de mettre l’accent sur l’actualité de l’action produite par des individu-e-s actifs/actives ensemble, de la coopération, des coopératives, de l’association des producteurs/productrices, de l’autogestion. Les auteurs nous rappellent « le caractère social du travail », que « l’individu ne se développe que dans un collectif qui lui permet de jouer son rôle et réciproquement, le collectif devient de plus en plus collectif d’individualités et non une masse indifférencié ».
La radicalité de Karl Marx s’exprime à la fois sur la nécessaire auto-organisation des dominé-e-s, leur association en collectifs, y compris dans la sphère de la production et dans le combat contre les structures de l’État. Il ne s’agit ni de s’en remettre aux forces institutionnelles, ni à l’État qui ne peut être considéré comme neutre dans les rapports sociaux.
Les auteurs développent aussi sur les gratuités, les droits sociaux, les patrimoines communs, le fétichisme de la marchandise, les conventions collectives, la domination réelle et la domination formelle, les expériences collectives cristallisées dans les organisations syndicales, les bouleversements du travail, l’automation, le « general intellect », le bilan des nationalisations en France et en Urss, l’internationalisme, l’inter-complémentarité, la démocratie…
Les coopératives, les formes collectives d’actions ne peuvent être cependant appréhendées « hors de la capacité d’intégration du système capitaliste ». D’où la question du pouvoir d’État, la nécessité d’une « réorganisation socialement majeure » de la production, de l’organisation sociale et politique.
J’ai été particulièrement intéressé par le chapitre sur « Le temps et les possibles au présent ». Les auteurs y soulignent, entre autres, « la place et la portée historique des coopérations multiformes qui peuplent la pratique politique et sociale : coopératives de production, exigences d’appropriation sociale des grandes entreprises et des services publics, remise en cause pratiques des transports, de l’agriculture et de la production d’énergie à partir de critères écologiques, critiques de la spéculation financière, des gaspillages mondialisés et des atteintes à l’environnement ». Face à l’ordre désordonné du monde, « les rapports de coopération et d’égalité, loin de se cantonner à des résistances, portent en effet des dynamiques de transformation révolutionnaire ».
Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka reviennent aussi sur certaines expériences actuelles : Céralep, imprimerie Hélio-Corbeil, aciéries de Ploërmel, SET ou Fralib… ; et à l’international : le printemps de Prague, l’Argentine, la Grèce ou l’Espagne… « Même si l’actualité d’une organisation de la production collective et maîtrisée démocratiquement a pu être négligée, voire parfois combattue par certains courants du mouvement ouvrier, elle s’affirme et revient sans cesse, dès que l’occasion se présente et que quelques forces s’y attellent pour résister et éventuellement contre-attaquer ».
Pourquoi accepter la rationalité irrationnelle de la planification privée pour le profit ? Pourquoi ne pas y opposer la production socialisée, non réductible à la caricature des nationalisations ? Il convient donc d’opposer les expropriations et la gestion collective à la propriété lucrative ; de répondre à « quelle est la limite des « biens communs », auxquels toute personne a droit ou devrait avoir droit ? », de s’appuyer sur les pratiques collectives, sur le « déjà là » (« La prise en compte des possibles au présent nous impose d’être attentifs aux aspects contradictoires de la réalité sociale mondialisée ») pour poser les questions du pouvoir, social, économique et politique.
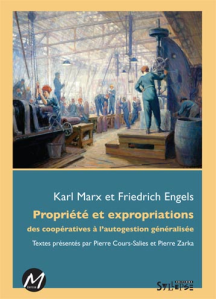 D’autres débats sont soulevés par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka, d’autres éléments d’analyses et de réponses sont présents dans les textes de Karl Marx et de Friedrich Engels. Parmi ceux-ci, je trouve peu satisfaisant ceux sur la notion de « communisme » et sur la « destruction de l’État », sans oublier les silences (mais ce n’était pas l’objet du livre) sur les contradictions entre les différents niveaux de contrôle ou d’autogestion, tant au niveau régional, national, continental ou international..
D’autres débats sont soulevés par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka, d’autres éléments d’analyses et de réponses sont présents dans les textes de Karl Marx et de Friedrich Engels. Parmi ceux-ci, je trouve peu satisfaisant ceux sur la notion de « communisme » et sur la « destruction de l’État », sans oublier les silences (mais ce n’était pas l’objet du livre) sur les contradictions entre les différents niveaux de contrôle ou d’autogestion, tant au niveau régional, national, continental ou international..
Un livre incitation à relire Marx, non comme des talmudistes, mais comme une source de réflexion combinant analyses, théorisations, pratiques, histoire et inventions…
Karl Marx /Friedrich Engels : Propriété et expropriations. Des coopératives à l’autogestion généralisée
Textes présentés par Pierre Cours-Salies et Pierre Zarka
Editions Syllepse, Editions Syllepse – Propriété et expropriations, Coédition avec M Éditeur (Québec), Paris 2013, 181 pages, 12 euros
Didier Epsztajn














