Rapport sur les opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des oppositions à la construction de l’autoroute A69
Le projet d’autoroute A 69 Toulouse – Castres fait l’objet, depuis plusieurs années, d’une contestation multiforme. Les observateurs de l’Observatoire toulousain des Pratiques Policières – OPP ont, depuis plus d’une année maintenant, observé, dans le Tarn comme à Toulouse, les pratiques policières dans le cadre des initiatives et manifestations organisées par les opposants à ce projet autoroutier. La séquence d’observation qui fait l’objet du rapport publié en ce mois de mai 2024 concerne les opérations de police et de gendarmerie menées sur la commune de Saïx, au lieu-dit La Crémade, où des groupes d’opposants ont occupé un espace boisé situé sur le parcours de la future voie autoroutière et construit des cabanes dans des arbres promis à l’abattage.
Si nous ne devions retenir qu’une seule chose de cette séquence d’observations dans le Tarn, c’est celle qui concerne la militarisation des opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des contestations sociales en France. Blindés Centaure, hélicoptères, lanceurs Cougar, lanceurs multi-coups PGL 65, lanceurs de balles de défense, grenades explosives, à fragmentation, assourdissantes, lacrymogènes, la quasi-totalité de l’arsenal de la police et de la gendarmerie françaises a été déployée et utilisée à Saïx. Seuls les fusils d’assaut et les armes de poing, bien présents, n’ont pas été utilisés…
Ce que les observateurs ont constaté à Saïx est une illustration, concentrée dans le temps et dans l’espace, de ce qui se déroule aujourd’hui dans notre pays. Il est devenu urgent que soient mis en place des moyens de contrôle, indépendants du pouvoir, sur les pratiques policières. Il n’est plus possible de laisser perdurer la situation qui prévaut actuellement où se mêlent une instrumentalisation de la police et de la gendarmerie à des fins de carriérisme politique, local comme national, et une absence de comptes à rendre sinon au travers de structures, IGPN et IGGN, gérées par les corps d’appartenance de ceux et celles qui sont les acteurs des faits délictuels et pénaux qui font l’objet des enquêtes menées.
Synthèse
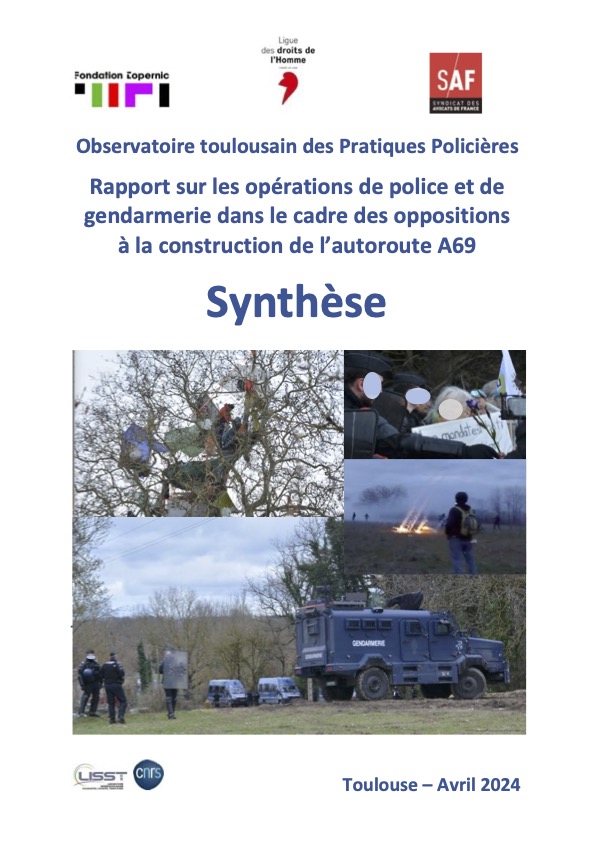
Préambule L’observatoire toulousain des Pratiques Policières
La création, en 2017, de l’observatoire toulousain faisait suite aux constats, concernant les déploiements et pratiques policières, effectués sur le terrain par des militants de la Ligue des droits de l’Homme, de la fondation Copernic et du SAF – Syndicat des Avocats de France durant les manifestations qui, en 2014, ont suivi la mort de Rémi Fraisse, tué par l’explosion d’une grenade GLIF4 à Sivens (dans le Tarn, déjà) dans le cadre de la mobilisation contre un barrage destiné à l’irrigation et durant les manifestations de 2016 à Toulouse contre la loi « Travail », dite loi El Khomri. L’OPP a, depuis lors, observé les pratiques policières lors de 250 manifestations et rassemblements dans l’espace public.
L’OPP n’a pas de personnalité morale. Il s’agit d’un collectif militant qui travaille sous l’égide des trois organisations précitées. Ces trois organisations apportent aux observateurs un soutien financier et logistique et mettent au service des observateurs leurs propres expertises, juridiques en particulier.
La création de l’observatoire et ses activités se sont déployées grâce à l’appui d’un enseignant-chercheur rattaché à un laboratoire de sociologie, le LISST – Laboratoire Interdisciplinaire Solidarités – Sociétés – Territoires, affilié au Centre National de la Recherche Scientifique – CNRS, de l’université Toulouse-Jean Jaurès. L’observatoire se revendique depuis sa création d’une démarche scientifique et engagée. Si une démarche empirique (de l’observation naît l’analyse) est toujours au cœur du travail des observateurs, la participation à des échanges réguliers avec d’autres observatoires créés en France métropolitaine a conduit l’OPP à s’inscrire de plus en plus dans une démarche intégrant les textes internationaux régissant le droit des observateurs indépendants (textes de l’ONU et de l’OSCE – Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe – en particulier).
Une séquence d’observation très dense
Le projet d’autoroute A 69 Toulouse – Castres fait l’objet, depuis plusieurs années, d’une contestation multiforme. Les observateurs de l’Observatoire toulousain des Pratiques Policières – OPP ont, depuis plus d’une année maintenant, observé, dans le Tarn comme à Toulouse, les pratiques policières dans le cadre des initiatives et manifestations organisées par les opposants à ce projet autoroutier. La séquence d’observation qui fait l’objet du rapport publié en ce mois de mai 2024 concerne les opérations de police et de gendarmerie menées sur la commune de Saïx, au lieu-dit La Crémade, où des groupes d’opposants ont occupé un espace boisé situé sur le parcours de la future voie autoroutière et construit des cabanes dans des arbres promis à l’abattage. Comme c’est le cas depuis la création de l’OPP, les observateurs se sont auto-saisis et ont décidé d’aller sur site pour observer, documenter et analyser les pratiques de la police et de la gendarmerie, très présente dans cet espace rural, dans le cadre de leur déploiement organisé sous l’égide de l’État et de la préfecture du Tarn.
Cette séquence d’observation, très dense, couvre la période allant du 10 février au 24 mars 2024 et s’est traduite par la venue d’équipes d’observateurs 18 fois sur site. Ce sont donc des dizaines d’heures d’observation menées durant ces six semaines par des groupes de 3 à 6 observateurs et la prise de centaines de photos et vidéos qui sont traitées et analysées dans le rapport qui fait l’objet de la présente synthèse.
1 – Des entraves répétées et quasi permanentes à la liberté d’informer et d’observer
Nous avons largement documenté les entraves dans le rapport. Comment accepter que durant des semaines les journalistes aient été, dans leur grande majorité, interdits de faire leur métier, allant même jusqu’à être bousculés par des gendarmes. Dans un premier temps, l’argument invoqué pour justifier cette interdiction était celle de l’impossibilité de pénétrer sur un terrain privé. « Vous êtes sur un terrain privé, veuillez sortir de celui-ci » répétaient à l’envi gendarmes et policiers. Et puis, une fois le campement au pied des arbres évacué le 15 février, ces mêmes gendarmes et policiers ont, tel un leitmotiv, asséné pendant des jours et des jours la phrase suivante : « Opération de police judiciaire en cours, vous ne pouvez pas passer ».
Si on peut imaginer que pendant un court laps de temps, un périmètre puisse être sécurisé par des policiers et gendarmes dans le cadre d’une opération de police judiciaire, rien, au regard de la situation qui a prévalu durant des semaines à Saïx, ne justifiait cette restriction drastique de la liberté d’informer. Il en va bien sûr de même pour la liberté d’observer et de documenter l’action des gendarmes et policiers comme le font les observateurs de l’OPP dans le cadre des textes internationaux.
Michel Forst, rapporteur spécial de l’ONU, ne s’y est d’ailleurs pas trompé quand il écrit dans son rapport publié le 29 février suite à sa visite sur site et aux entretiens auxquels elle a donné lieu : « Bien qu’une opération de police judiciaire puisse justifier certaines restrictions d’accès au site, celles-ci devraient être strictement limitées et clairement définies. Les obligations internationales de la France, notamment liées au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, comprennent la facilitation de l’exercice de leurs fonctions par les observateurs ».
2 – Une nouvelle démonstration de la militarisation du maintien de l’ordre en France
Si nous ne devions retenir qu’une seule chose de cette séquence d’observations dans le Tarn, c’est celle qui concerne la militarisation des opérations de police et de gendarmerie dans le cadre des contestations sociales en France. Il n’y a jamais eu moins d’une petite cinquantaine de gendarmes appartenant à des Escadrons de Gendarmerie Mobiles – EGM et/ou de policiers des Compagnies Républicaines de Sécurité – CRS présents sur site. Leur nombre est allé jusqu’à la présence simultanée d’un escadron de gendarmes mobiles (une centaine de gendarmes) et d’une compagnie de CRS (une centaine de policiers aussi) ; soit environ 200 policiers et gendarmes.
Les observateurs ont aussi noté l’encadrement de haut niveau présent sur site avec des gendarmes de tous grades y compris la présence, le 18 février, d’un général de la gendarmerie et la venue dans le Tarn du Directeur général de la Gendarmerie Nationale, le général d’armée Christian Rodriguez, le 15 mars. Le Préfet, la Directrice de cabinet du préfet ainsi que le Secrétaire général de la préfecture (tous deux ayant grade de sous-préfet) ont été aussi aperçus sur place. Ce déploiement important de l’appareil d’État montre, s’il en est besoin, l’importance accordée au plus haut niveau à ce dossier.
Blindés Centaure, hélicoptères, lanceurs Cougar, lanceurs multi-coups PGL 65, lanceurs de balles de défense, grenades explosives, à fragmentation, assourdissantes, lacrymogènes, la quasi-totalité de l’arsenal de la police et de la gendarmerie françaises a été déployée et utilisée à Saïx. Seuls les fusils d’assaut et les armes de poing, bien présents, n’ont pas été utilisés…
Un exemple de cette utilisation « débridée » de la force est l’usage de celle-ci le 1er mars lorsque des soutiens, moins d’une centaine de personnes, ont tenté de s’approcher, sans violence, du bois de la Crémade pour apporter eau et nourriture aux occupants. Après un face-à-face, un peu tendu avec quelques légères bousculades au niveau du pigeonnier, les gendarmes présents ont fait usage de la force et ont, en 6 minutes, tiré au lanceur Cougar et, vraisemblablement avec le blindé Centaure, une trentaine de grenades lacrymogènes soit environ une grenade de 6 palets lacrymogène pour trois personnes… Les grenades ont même atterri au milieu des véhicules qui passaient sur la route de Semalens.
Cette évolution (militarisation et usage disproportionné de la force) déjà constatée à Sainte-Soline au printemps 2023, ne peut qu’inquiéter toutes celles et ceux qui sont attachés à la défense des libertés publiques dont celle de manifester et de mener des actions de résistance civile non-violente.
3 – Une politique de maintien de l’ordre qui doit être questionnée
Quand on analyse la séquence d’observations traitée dans le rapport de l’observatoire, plusieurs critères employés par les institutions internationales comme l’OSCE – Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe pour qualifier les pratiques policières dans le cadre de la gestion des manifestations sont utiles pour mener cette analyse. Parmi ceux-ci, arrêtons-nous sur trois d’entre eux : la nécessité / qui doit guider toute intervention, la proportionnalité / utiliser la force de manière aussi faible que possible et laredevabilité (« accountability » en anglais) / action de rendre des comptes. Si on met en perspective ces 3 critères d’analyse au regard des constats effectués ces dernières semaines, on peut affirmer que la police et la gendarmerie française ont été, à Saïx, « hors des clous » par rapport à ces principes.
* La nécessité Aucune nécessité n’a justifié le déploiement durant plusieurs semaines d’un dispositif de type militaire avec blindés, hélicoptères, armes de guerre ni l’utilisation de la force par les gendarmes et policiers avec moultes grenades explosives ou à fragmentation. Il faut avoir à l’esprit, quand on analyse la situation qui a prévalu en cet hiver 2024 à Saïx, qu’étaient présents sur site une quinzaine d’opposants occupant des arbres et quelques petites dizaines de soutiens au sol. Ces personnes s’opposaient, par la pratique, très ancienne, d’une résistance civile non-violente à l’abattage d’arbres dans le cadre d’un projet contesté d’autoroute dont tous les recours sont loin d’être purgés. Et ceci pour qu’à la fin soit validée leur alerte sur l’atteinte à la biodiversité qui était une de leurs raisons d’agir et que l’abattage des arbres soit abandonné. Mais qu’avait donc à craindre l’État français de ces petites dizaines de personnes pour mener un véritable siège en militarisant pendant des semaines un petit coin de campagne française ?
* La proportionnalité C’est une notion quasiment inconnue, par les policiers et gendarmes sur le terrain comme par leur commandement. Au-delà du déploiement policier mais aussi militaire conséquent tant en termes de moyens matériels qu’en termes de moyens humains que nous pourrions qualifier trivialement de « délirant », l’usage de ceux-ci a été totalement disproportionné. Les gazages massifs provoquant un traitement indiscriminé des personnes présentes et l’usage offensif de centaines et centaines de grenades de tous types et des LBD sont là pour le prouver. Au vu de ce que les observateurs ont pu constater sur le terrain, tout était fait pour conduire à des affrontements, asymétriques, entre les plus déterminés des soutiens aux occupants des arbres et les gendarmes et policiers. « Comparaison n’est pas raison » dit l’adage ; mais une certaine analogie peut être faite entre ce qui est advenu il y a un an à Sainte-Soline et ce qui s’est passé à Saïx ces dernières semaines.
* La redevabilité Celle-ci consiste à devoir rendre des comptes. Nous sommes, là aussi, loin du compte. À aucun moment l’usage de la force et de tous les matériels et munitions utilisés dans le Tarn n’a fait l’objet d’une quelconque justification autre que d’autorité. Et quant à rendre vraiment des comptes, nous en sommes loin.
L’État français doit respecter les textes internationaux et contrôler sa police et sa gendarmerie
Ce que les observateurs ont constaté à Saïx est une illustration, concentrée dans le temps et dans l’espace, de ce qui se déroule aujourd’hui dans notre pays. Il est devenu urgent que soient mis en place des moyens de contrôle, indépendants du pouvoir, sur les pratiques policières. Il n’est plus possible de laisser perdurer la situation qui prévaut actuellement où se mêlent une instrumentalisation de la police et de la gendarmerie à des fins de carriérisme politique, local comme national, et une absence de comptes à rendre sinon au travers de structures, IGPN et IGGN, gérées par les corps d’appartenance de ceux et celles qui sont les acteurs des faits délictuels et pénaux qui font l’objet des enquêtes menées.
Le droit de porter une arme et d’éventuellement s’en servir, un droit exorbitant du droit commun, devrait conduire à une sélection et une formation rigoureuses des personnes relevant de ce droit. Et aucune tolérance ne devrait être de mise avec les policiers et gendarmes mais aussi avec ceux qui les couvrent quand ceux-ci ont des pratiques contraires aux textes nationaux et internationaux qui régissent les libertés publiques et le droit de manifester.
Télécharger la synthèse au format PdF : Synthèse rapport A69 V0
télécharger le rapport au format PdF : Rapport A69 final
Pour télécharger les trois premiers rapports de l’OPP sur le site des archives ouvertes du CNRS
1er rapport – Avril 2019 – « Toulouse : un dispositif de maintien de l’ordre disproportionné et dangereux pour les libertés publiques »
https://hal.science/hal-02103935
2ème rapport – Avril 2021 – « L’Observatoire toulousain des Pratiques Policières – 4 ans après »
https://hal.science/hal-03207613
3ème rapport – Novembre 2023 –« Maintien de l’ordre – Une dérive liberticide et violente »
https://hal.science/hal-04301348v2
Pour tout contact : opptlse@gmail.com
