au livre de Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité
Avec l’aimable autorisation des Editions Syllepse
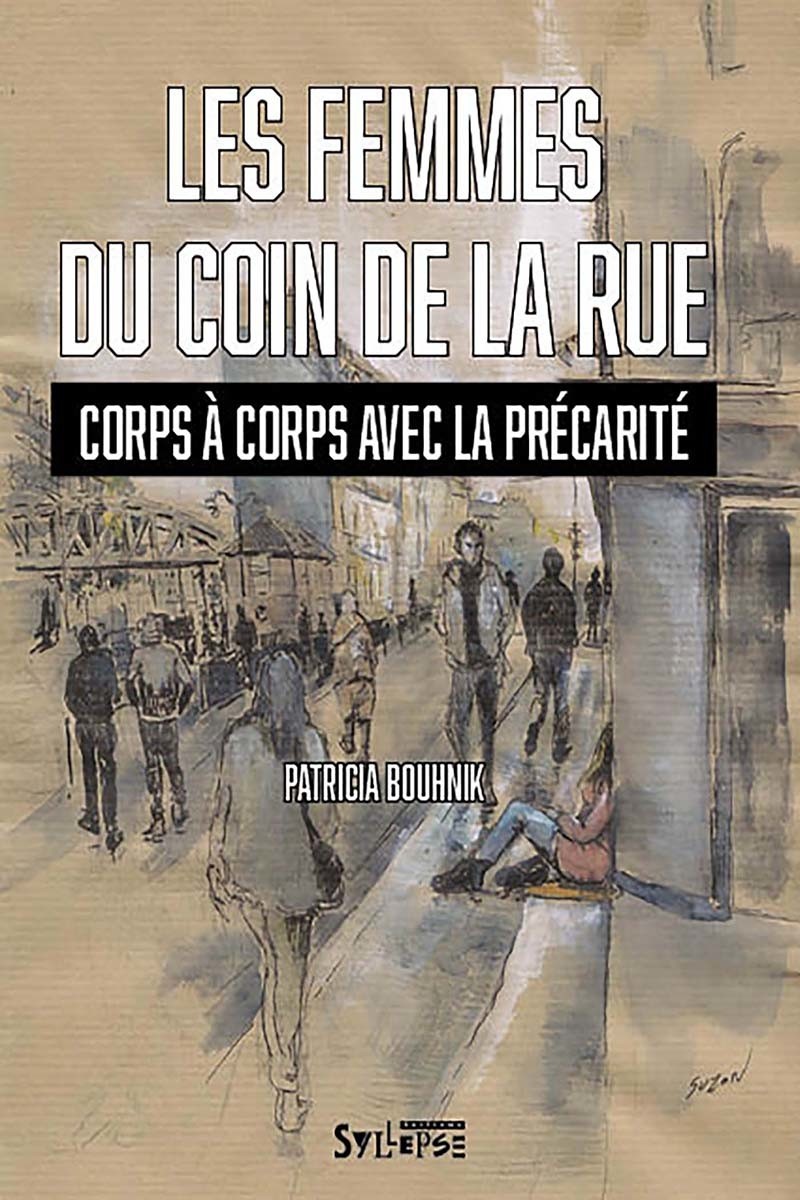
« Depuis toujours, sortir de sa cage a été accompagné de sanctions brutales […] C’est l’idée que notre indépendance est néfaste qui est incrustée en nous jusqu’à l’os1. »
Ce livre est une invitation au voyage dans les territoires obscurs de Paris, dans les plis et replis de la ville, dans les marges, les franges, les « angles morts » de l’espace public. Il est une invitation à regarder et à entendre celles qu’on ne veut pas voir : les femmes pauvres, jeunes ou vieilles, désaffiliées, qui vivent avec ou dans la rue. Trop souvent rendues muettes, réduites à des ombres, à des figures sombres et déviantes du féminin. Femmes « infâmes », a priori peu respectables, il s’agit de leur redonner forme et voix. Au-delà de la diversité de leurs trajectoires et de leur quotidien, « leur point commun, écrit Patricia Bouhnik, c’est l’absence de place, de qualités reconnues, de droits et de ressources ». Il s’agit alors de restituer une part à ces sans-part2, de rendre compte de la capacité de celles qu’on juge incapables, de compter les incomptées, rejetées aux bords de la ville comme du politique.
Les « vies périphériques, infimes et méprisées3 », quand elles se déclinent au féminin, continuent d’être « reléguées aux oubliettes ». Chercher à en rendre compte suppose alors d’explorer les « silences de l’histoire4 », de documenter les processus historiques et contemporains d’invisibilisation, voire de disparition – ces processus qui conduisent à ne plus voir ces femmes, à ne plus vouloir les voir.
Il faut remonter au 19e siècle, ce moment où les frontières de genre et les frontières de l’espace urbain sont politiquement redessinées et progressiment incorporées. La ville du 18e siècle, rappelle Arlette Farge, est bruyante, bouillonnante et marquée par la forte présence des femmes issues des milieux populaires5. Le 19e siècle opère un « grand nettoyage ». Les politiques hygiénistes contribuent à vider les rues des « indésirables », les plus pauvres, relégué.es aux marges, associé.es au risque. Dans cette ville moderne décrite par Georg Simmel ou Walter Benjamin, seuls sont autorisés les modèles du flâneur et de la flâneuse : ils « incarnent et portent ostensiblement un modèle de comportement auquel les membres des classes bourgeoises vont adhérer et dans lequel ils vont se reconnaître ». Cette nouvelle police de l’espace public et de la précarité est aussi une police du genre : les femmes qui occupaient les rues et les centres sont désormais assignées à la sphère « privée », à des fonctions de mères et d’épouses. « Ce siècle d’effacement d’une partie des femmes s’est accompagnée de la catégorisation et de la disqualification des contrevenantes : mendiantes, prostituées, vagabondes », rappelle Patricia Bouhnik.
Les pandémies, et celle, plus récente, de la Covid-19, n’ont fait qu’accélérer encore le processus. Les mesures de confinements ont crûment mis en lumière les inégalités sociales et les vulnérabilités. Elles ont aussi conduit celles et ceux qui vivent avec, de, ou dans la rue, à se cacher encore davantage. Et les femmes, là encore, ont payé le plus lourd tribut : dans les logements, elles ont assuré l’ensemble des tâches éducatives et domestiques. La coexistence des sphères d’activité pour les deux sexes aurait pourtant pu donner lieu à des configurations inédites et plus égalitaires. Au-dehors, les « femmes contraintes de vivre à la rue, d’y traîner, d’y stationner, faute d’espace et de ressources, sont toujours là, avec la nécessité de se faire plus discrètes que jamais ». Les glaneuses ne peuvent plus glaner, celles qui vivent de la prostitution ou de la mendicité sont obligées de se cacher davantage. Les modifications architecturales récentes liées à l’organisation des Jeux olympiques, couplées aux lois répressives sur l’immigration et les usages de drogues, repoussent les précaires, exilées, racisées, encore plus loin dans les coulisses de l’espace public urbain. Dans ce contexte, rester invisibles est un principe de survie : il ne faut pas donner prise. S’abriter du stigmate pour ne pas « faire tache dans le paysage ». Éviter les contrôles policiers. Se protéger des violences masculines, omniprésentes.
On compte trop peu les mortes à la rue et les sciences sociales ont joué un rôle dans ce processus de disparition. Ce livre oblige à en prendre la mesure. En dehors de la question prostitutionnelle, les recherches sur la dimension genrée des formes contemporaines de la désaffiliation et des modes de présence et d’existence dans les marges de l’espace public et urbain, sont récentes. Dans les travaux de sociologie urbaine ou de sociologie de la déviance, « le coin de la rue » a, pour l’essentiel, jusque-là désigné, un lieu de sociabilité masculine et de construction de masculinités populaires. On pense, bien sûr, à l’ouvrage de William Foote Whyte, Street Corner Society (1 943), auquel le titre de ce livre fait explicitement référence6. On n’y croise que des hommes, « des femmes ont pourtant toujours été là, au coin de la rue, à la fois diverses, cachées et proches ». Il s’agit dès lors de rompre avec cette forme d’aveuglement pour repenser ces espaces, en s’attardant sur les trajets, les trajectoires et le quotidien de femmes qui, elles aussi, les traversent, les habitent parfois. Cet ouvrage propose une cartographie nouvelle de la ville et de ses marges. « Je suis partie de ces disparitions-là pour tisser le fil des histoires, recouper les contextes et déterminants et tenter de restituer la force des expériences et capabilités engagées », écrit Patricia Bouhnik.
Rendre compte de ces « composantes silencieuses et masquée de la vie sociale », demande du temps : dix années de rencontres et d’échanges, d’« équipées ethnographiques » avec une trentaine de femmes qui vivent dans la rue, dans les quartiers du nord-est de Paris et de l’autre côté du périphérique. Prendre le temps, c’est aussi accepter d’être mise à distance, c’est attendre d’être autorisée, de respecter les distances imposées, c’est parler de soi, de ses trois enfants notamment, de sentir et de ressentir, les odeurs, le froid, de se retrouver parfois dans des formes d’incertitude morale. C’est les suivre dans les kilomètres parcourus au quotidien sans jamais s’imposer. Ou encore rester assise avec elles, sur un banc, à même le sol, dans une tente ou dans une ancienne boutique de vêtements où se retrouvent des femmes vieilles et pauvres – mosaïque de petits mondes.
Rendre compte de ces existences fragiles c’est aussi nommer ces femmes. Les catégories de l’action publique ou de l’analyse sociologique n’y suffisent pas. Les nommer, c’est les reconnaître, les identifier, leur redonner un prénom propre : Josiane, Monique, Solange, Cathy, Brigitte, Riyina, Awa, Farhia, Houda, Anita, Marie, Louise, Violette, Jenny, Coralie, Corinne, Océane, Pauline, Anita, Halima, Yuan, Iny. Leur redonner corps aussi. « Vous avez un mètre dans la tête », dit Solange à Patricia. En leur donnant forme et figure, l’écriture nous oblige à voir les corps et les manières d’occuper l’espace, au-delà des « marques d’infamies à même la peau ». Elles sont blondes, brunes, les cheveux déjà gris, noires, blanches, ridées, décharnées, rondes, en pantalon le plus souvent, les yeux rendus hagards par la prise de crack, ou au contraire toujours à l’affût. Certaines s’efforcent de prendre soin de ce corps, d’autres, au contraire, s’attachent à gommer tout signe de féminité, préfèrent ne pas se laver : l’odeur permet de tenir les autres à distance. Lutter s’apprend par corps.
En traçant ces portraits, ces « vies précaires au bord du monde commun », Patricia Bouhnik repense les processus de désaffiliation et de discrimination en articulant rapports de genre, de classe, de race, d’âge et de sexualité. Ces trajectoires de précarisation sont marquées par des mises à l’écart successives : ruptures familiales ou conjugales, perte d’emploi, placement des enfants, exil, expulsions. Les violences de genre y jouent un rôle central, dans les espaces domestiques comme à la rue. Elles n’ont pas osé porter plainte ou la police n’a pas voulu les entendre. Certaines ont frôlé la mort, elles ont réussi à partir, s’appauvrissant encore. D’autres vivent ces violences au quotidien, taillent une pipe contre une dose de crack. Le déclassement se mesure aussi à des formes successives de dépouillement. Partie avec trois valises dans lesquelles Cathy a rangé son passé, il ne lui en reste plus qu’une aujourd’hui. La vie entière de Coralie tient quant à elle dans un sac à dos. Awa et Fahria n’ont plus de sac du tout.
Leur rapport aux institutions est marqué d’ambivalences. Certaines, migrantes, réfugiées et sans papiers, sans droits et sans ressources, fuient les contrôles policiers. Pour les autres, c’est la crainte des services sociaux qui domine : éviter à tout prix le stigmate de « mauvaise mère » quand elles ont encore leur enfant à charge. Accepter de l’aide, c’est aussi prendre encore le risque d’être violentée, cette fois dans les centres d’hébergement mixtes, tant les structures liées au sans-abrisme n’ont pas été pensées pour les femmes. Aller à la rencontre des « filles du coin de la rue » suppose alors de donner des gages : Patricia Bouhnik leur rappelle régulièrement n’être ni travailleuse sociale, ni policière, ni bénévole dans une association.
Au sens strict du terme, ces femmes ne constituent pas une « population » ni un tout homogène. Toutes ne sont pas logées à la même enseigne, « leurs histoires et leurs modes d’inscription dans la ville sont disparates ». Là est une des grandes forces de cet ouvrage : il souligne les différences pour montrer comment le quotidien de la précarité est lui-même traversé par des inégalités, les rejoue même. Pour négocier leur place, pour ne pas perdre complètement la face, les femmes rencontrées tâchent sans cesse de se distinguer, de mettre à distance les stigmates. Elles mobilisent des figures féminines repoussoirs auxquelles il ne faudrait surtout pas être assimilées. Monique évite celles qu’elle considère comme « sans dignité ». Louise ne veut pas « passer pour une marginale ». Entretenir ces distinctions est vital. Cela fait partie des « microstratégies » qui « misent sur une habile utilisation du temps, des occasions qu’il présente et aussi des jeux qu’il introduit dans les fondations d’un pouvoir7 ». Pour les saisir, le regard sociologique se concentre sur l’infiniment petit, le difficilement dicible – condition nécessaire pour comprendre les capacités des « incapables ».
Patricia Bouhnik met ainsi en évidence l’important travail déployé par ces femmes pour survivre. Non marchand, non reconnu, invisible, il s’agit bien d’un travail. Que Ryana nomme d’ailleurs comme tel. Il concerne le corps au premier chef. Corps-ressource, il est aussi toujours menacé. Pour ne pas subir de violences supplémentaires, il s’agit de déployer des techniques, d’intérioriser de nouveaux codes corporels, d’être au monde. On les perçoit dans les manières de se vêtir, de parler, de se mouvoir, d’affirmer un possible usage de la violence pour se défendre. Le corps peut aussi constituer une monnaie d’échange. Il faut alors payer de sa personne, « la norme de domination et de servitude volontaire est pratiquée ici à l’amiable ». Pour d’autres, en prendre soin est un moyen de se maintenir dans un état de « femmes respectables8 ». Dans ce contexte, les atteintes corporelles et la maladie sont lourdes de conséquences : elles constituent un risque supplémentaire de déclassement pour ces femmes qui, par ailleurs, ont très peu accès aux soins.
Ce travail désigne aussi les systèmes de débrouille et de survie mis en place pour trouver des ressources mentales et matérielles pour soi et pour les autres. Travail au noir, services sexuels, ramassage d’objets dans les rues pour les revendre ensuite, vols, constituent le travail d’« interstices » . Il désigne également les manières d’habiter : les places choisies sur le trottoir, les tentes ou les caravanes sont savamment aménagées. Ces intérieurs parfaitement rangés permettent, malgré tout, de construire une forme de « chez-soi ». Comme ailleurs, le travail est aussi domestique et de care : « Les mères et les sœurs, dans ces configurations de précarité et de malheur quotidiennes, se trouvent en première ligne pour supporter les charges et se sacrifier pour la famille. » Même placés, les enfants restent omniprésents dans l’esprit de leur mère.
Les capacités des « incapables » se logent, enfin, au cœur des solidarités et des jeux d’interdépendance mis en place – formes fragiles et nécessaires de sororité quand il s’agit, ensemble, de « faire corps ». Au final, ce livre est politique : il rappelle avec force que les « filles du coin de la rue » font partie du monde commun.
Coline Cardi9
Patricia Bouhnik : Les femmes du coin de la rue. Corps à corps avec la précarité
https://www.syllepse.net/les-femmes-du-coin-de-la-rue-_r_22_i_1067.html
1. Virginie Despentes, King Kong Théorie, Paris, Grasset, 2006.
2. Jacques Rancière, Aux bords du politique, Paris, Le Seuil, 1990.
3. Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », dans Dits et écrits III, Paris, Gallimard, 1994.
4. Michelle Perrot, Les femmes ou les silences de l’histoire, Paris, Flammarion, 1998.
5. Arlette Farge, Vivre dans la rue à Paris au 18e siècle, Paris, Gallimard/Julliard, 1979.
6. William Foote Whyte, Street Corner Society : The Social Structure of an Italian Slum, Chicago, University of Chicago Press, 1943 (traduction française : Street Corner Society, Paris, La Découverte, 1995).
7. Michel de Certeau, L’invention du quotidien, t. 1 : Arts de faire, Paris, Gallimard, [1980] 1990, p. 63.
8. Beverley Skeggs, Des femmes respectables : classe et genre en milieu populaire, Marseille, Agone, 2015.
9. Sociologue, maîtresse de conférences à l’Université Paris 8 et chercheuse au Cresppa/CSU. Ses travaux portent sur la dimension genrée du contrôle social et de la régulation, notamment au travers des figures de la « délinquante » et de la « mauvaise mère ». Elle a codirigé, avec Geneviève Pruvost, l’ouvrage Penser la violence des femmes (Paris, La Découverte, 2012).
